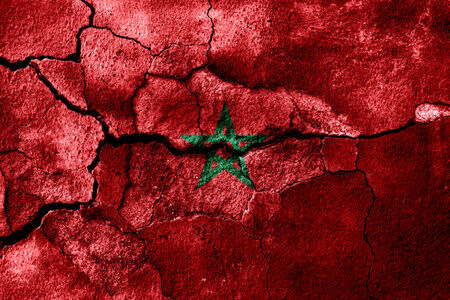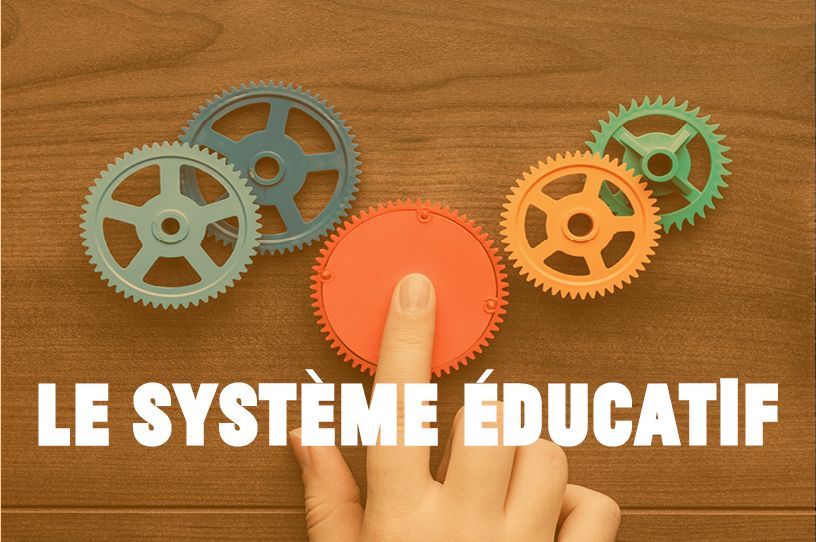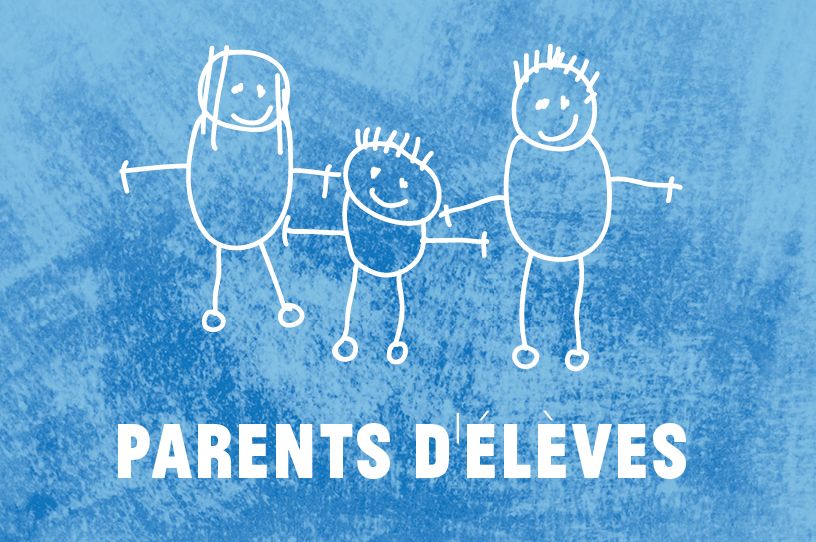Les neurosciences au scanner
Mis à jour le 27.03.18
6 min de lecture
Avec la nomination d’un neuroscientifique à la tête du nouveau comité scientifique au ministère, les neurosciences font à nouveau parler d’elles. Mais que nous apprennent-elles vraiment ?
Elles sont devenues la coqueluche des médias et de la rue de Grenelle. Les neurosciences, discipline scientifique relativement récente, à peine une cinquantaine d’années, font partie d’un champ plus large de la recherche, celle des « sciences cognitives ». Mis sur le devant de la scène par le formidable développement de l’imagerie médicale, les progrès récents réalisés en matière de neuro-imagerie donnent ainsi l’illusion de pouvoir visionner le fonctionnement du cerveau en temps réel. La méthode la plus employée consiste à comparer deux tâches différentes réalisées par une même personne impliquant ou non un processus mental donné et à observer les aires du cerveau qui montrent des différences d’activation entre ces deux tâches. L’hypothèse, qui reste non vérifiée actuellement, est de considérer que ce sont les aires cérébrales qui ont généré une activité électrique qui sont impliquées dans le processus mental testé. L’ingénierie mise en place avec des techniques comme la tomographie, qui consiste à mesurer l’émission de Positron ou encore l’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle (Irmf), toutes deux assistées par l’ordinateur pour produire des résultats, influence fortement notre position de jugement du caractère scientifique et donc « vrai » de cette nouvelle discipline. Des chercheurs eux-mêmes le disent et n’hésitent pas à parler de neuro-illusion voire de neurophilie, expliquée en grande partie par la fascination du public relayée par les médias sur toutes les découvertes qui concernent la connaissance de notre cerveau.
Les neurosciences et l’apprentissage
Pour la plupart des neuroscientifiques, les processus d’apprentissage s’opèrent par modification des connexions entre les neurones. Une information retenue entraîne de nouvelles connexions neuronales appelées « plasticité synaptique ou cérébrale ». Si les chercheurs ne sont pas capables d’observer en direct cette plasticité liée au processus cognitif, il semble néanmoins que ce processus soit absolument nécessaire à l’apprentissage. Ils distinguent une plasticité intrinsèque à l’individu qui faisant un certain nombre d’expériences peut adapter son comportement et acquérir des compétences. C’est le cas pour la vue, l’ouïe… et une plasticité extrinsèque qui correspond aux compétences transmises socialement, que ce soit dans la vie courante ou à l’école par exemple. À cette plasticité s’ajoute une notion importante, la « connectivité fonctionnelle » qui va générer des modes de gestion de cette plasticité. Mémoire de travail, mémoire à long terme, mécanisme de prise de décision ou encore gestion des émotions vont être en permanence sollicités pour participer d’une intelligence générale.
Aussi comme le rappelait Olivier Houdé, professeur de psychologie, dans Le Monde du 8 février dernier, il ne faut pas céder à « une vision trop scientiste et naïve voire idéologiquement dangereuse, d’une technoscience de l’éducation parfaitement contrôlée et contrôlable ». Cela ne devant pas empêcher dans le même temps « qu’une recherche pédagogique nouvelle, exploitant les ressources actuelles de l’imagerie cérébrale et de la psychologie expérimentale, puisse éclairer certains mécanismes neurocognitifs élémentaires d’apprentissage dont dépendent des phénomènes éducatifs, sociaux et culturels plus complexes ».
Cette complexité est à l’origine de la difficulté d’enseigner au quotidien dans la classe face à des élèves qui ne sauraient être réduits à des souris de laboratoire. Une difficulté qui peut expliquer la tentation de céder aux sirènes de réponses simplistes que certains seraient tentés d’imposer.
Interview d'Édouard Gentaz, professeur de psychologie du développement à l’université de Genève
Que nous apprennent les neurosciences ?
Les neurosciences permettent de distinguer les réseaux et les zones cérébrales impliqués dans un comportement. Elles essayent de comprendre les activités du système nerveux et ses corrélats notamment dans une situation d’apprentissage. Elles ont pu permettre de distinguer les zones du cerveau fonctionnelles dès la naissance de celles qui vont s’établir progressivement au cours du développement. Ainsi on a pu déceler la capacité chez des aveugles de naissance à ‘recycler’ des zones du cerveau habituellement réservées aux informations visuelles pour des tâches de lecture du braille par exemple. Quand une zone du cerveau n’est pas utilisée, elle peut évoluer vers d’autres fonctions et cette notion de plasticité cérébrale est une avancée importante des neurosciences.
Qu’en retenir pour faire la classe ?
Chaque fois que j’apprends quelque chose, je sculpte mon cerveau et parfois je peux recycler de nouvelles zones. Nos compétences sont beaucoup plus modulables que ce que l’on pensait. Tout n’est pas joué avant six ans et les corrélats neuronaux permettent de voir que le cerveau change avec le temps. Mais les recherches en neurosciences à elles seules ne peuvent guider les pratiques pédagogiques. Elles doivent être associées aux données d’autres disciplines, comme celles issues de la psychologie ou de la linguistique. On sait par exemple que travailler avec les élèves sur le fonctionnement de leur cerveau avec des activités de métacognition peut permettre de stimuler leurs performances scolaires.
Elles ne sont donc pas la recette miracle ?
Aucune approche scientifique ne peut donner de recette miracle, les neurosciences y compris. Il y a une mode ces dernières années à ajouter le préfixe neuro à toutes les disciplines comme si cela leur permettait d’être considérées comme davantage scientifiques ou sérieuses. Une sorte de neuro-illusion cognitive qui assimile à tort les neurosciences aux sciences cognitives appliquées à l’éducation. Par exemple affirmer que les neurosciences valident la pédagogie Montessori est un abus de langage. Seules quelques études comportementales de la psychologie et aucune en neurosciences montrent des bénéfices de cette pédagogie sur le développement cognitif et affectif des enfants et ces effets bénéfiques semblent s’expliquer par un contexte scolaire favorable à la créativité.