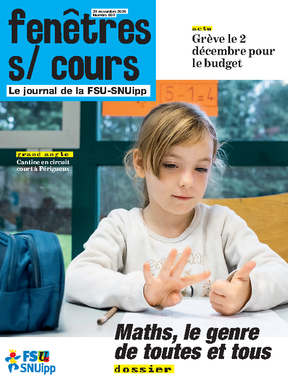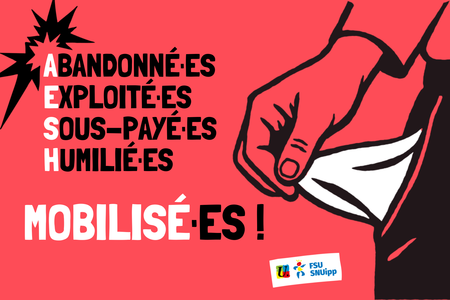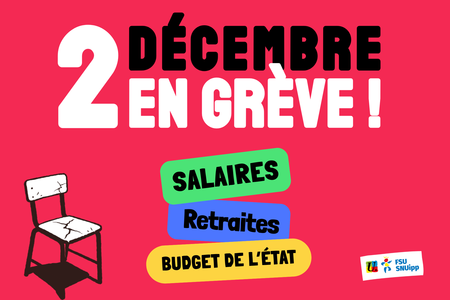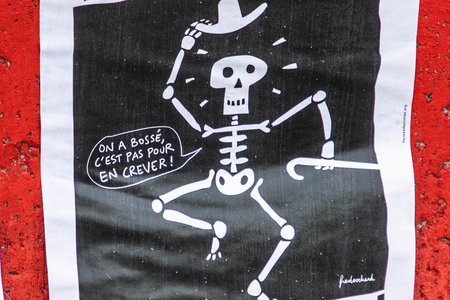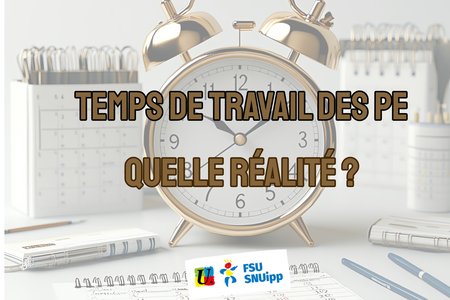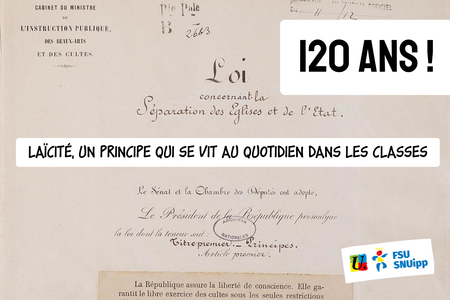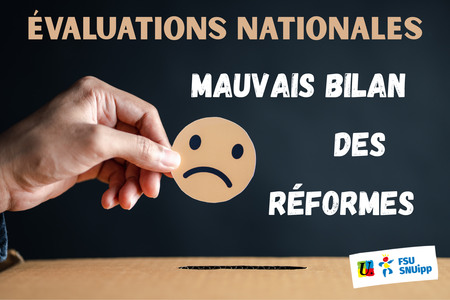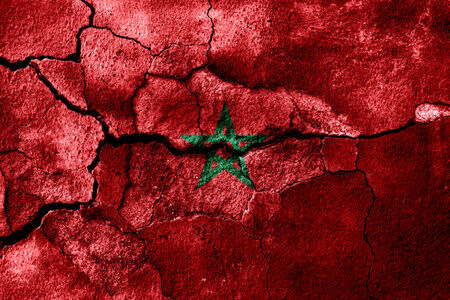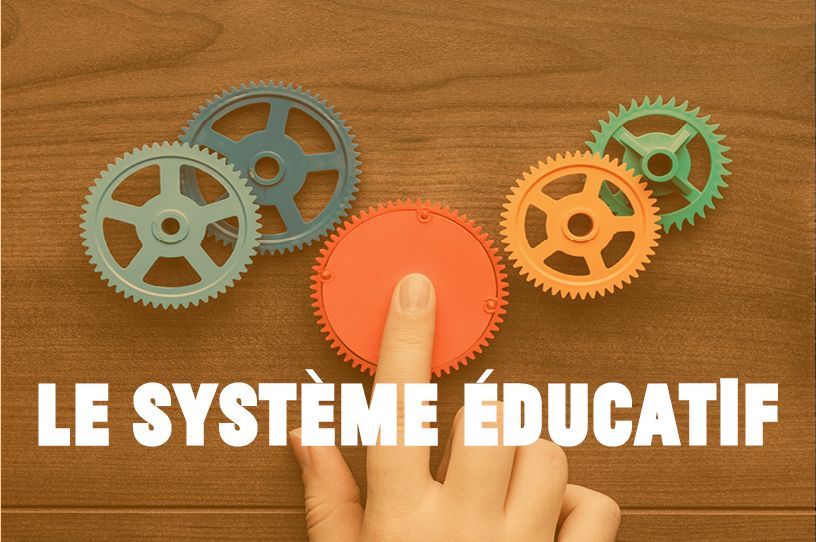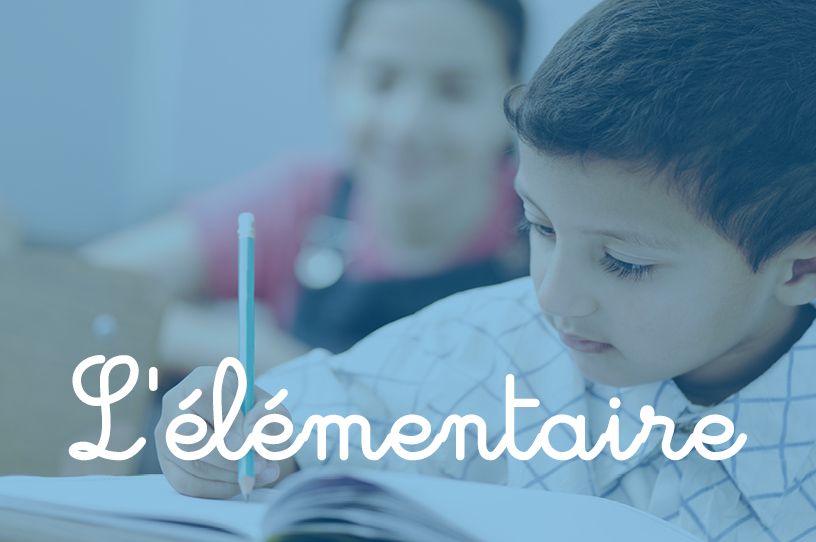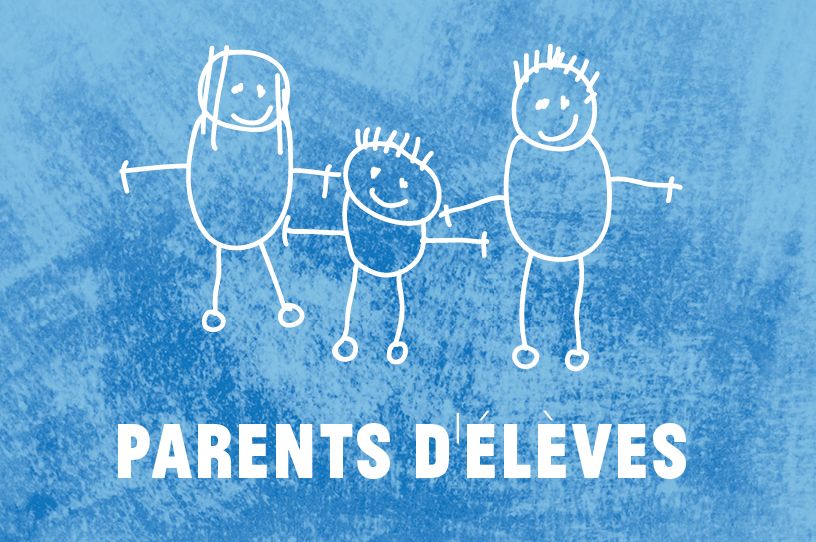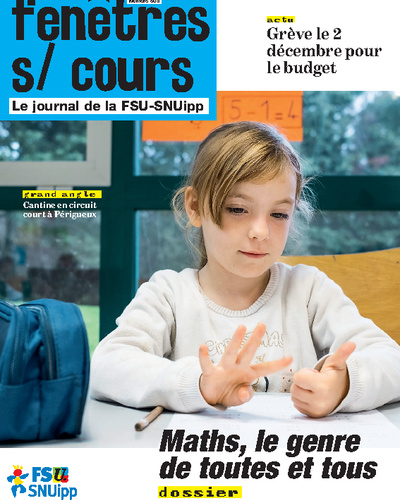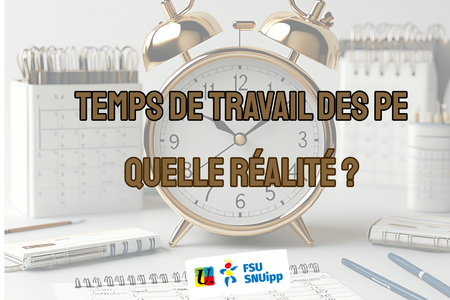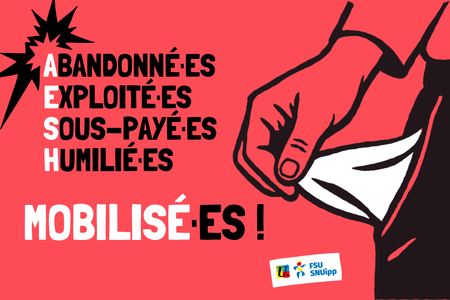Geneviève Avenard : quelle priorité aux enfants ?
Mis à jour le 19.11.18
min de lecture
20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. En France, malgré un dispositif législatif protecteur, il reste encore du chemin à parcourir pour mieux garantir les droits de tous les enfants et notamment des plus fragiles, mineurs étrangers isolées, enfants de familles pauvres, enfants placés ou encore ROMS. C'est ce qu'explique la Défenseure des enfants dans une interview pour le SNUipp-FSU.
Quels sont les droits des mineurs non accompagnés qui arrivent en France ?
Le nombre de ces jeunes, seuls et isolés augmente aujourd’hui de façon exponentielle en Europe et en France: le sujet préoccupe le Défenseur des droits depuis plusieurs années. Il faut vraiment souligner que ce sont des enfants avant tout. En cas de doute de leur minorité, cela doit être tranché au bénéfice du jeune. Or, c’est rarement le cas, ils sont souvent d’abord perçus comme des étrangers, à priori majeurs et à priori fraudeurs. Suite à des parcours d’exil faits de ruptures, de violences et de traumatismes multiples, ces jeunes devraient être protégés, avoir droit à la santé et à l’éducation, conformément à la Convention des droits de l’enfant. Pouvoir trouver des lieux où se ressourcer, se poser. Or, ils se retrouvent parfois dans des hôtels dits sociaux où il n’y a aucune présence d’adulte, ni pour les rassurer ni les accompagner ; et parfois, ils sont à la rue.
Quelles sont vos recommandations sur ce sujet ?
Nous préconisons que l’état soit davantage présent au côté des départements, chef de file de la protection de l’enfance, dans un objectif d’égalité territoriale. Ce sont souvent les associations qui pallient le manque d’accueil, mais cela n’est pas structuré, les aides ne sont pas pérennes.
Nous avons également rappelé la nécessité d’établir un climat de confiance lors de l’évaluation de la minorité, avec une prise en charge par des professionnels formés, ce qui reste encore trop aléatoire. Cela s’ajoute aux traumatismes déjà présents. Le Défenseur des droits s’est opposé fermement aux tests osseux pratiqués pour déterminer la minorité. Ils sont inadaptés, inefficaces et indignes.
L’accès à l’éducation n’est pas une évidence partout en France ?
Notre rapport de 2016* consacré au droit fondamental à l’éducation a montré que, contrairement à ce que l’on pouvait penser, un certain nombre d’enfants reste éloigné de l’école dans notre pays. Notamment lorsque les maires refusent les inscriptions. Ces discriminations sont principalement liées à l’origine, la précarité, le lieu d’habitation. Cela touche par exemple les familles hébergées en hôtel social, mais aussi les gens du voyage lorsque les transports scolaires ne se rendent pas jusqu’aux aires ou que des maires, par des règlements, excluent les familles installées provisoirement sur leur commune. Cela accroît les difficultés de parents déjà en précarité et qui ont pourtant une conscience forte que l’école est un moyen pour s’en sortir. Lorsque nous sommes saisis par les associations, des avocats ou des personnels de l’éducation nationale, nous intervenons auprès des maires ou des préfets en faisant un travail pédagogique de persuasion, basé sur le droit.
Concernant les droits de l’enfant, quel est l’état des lieux en France ?
Nous sommes dans un pays où il existe beaucoup d’actions positives en direction des enfants et un dispositif législatif protecteur. Notre travail consiste à vérifier l’effectivité du respect de ces droits et ils sont généralement respectés. Toutefois, nous observons que les enfants étrangers en famille ou isolés, les ROMs, les enfants pauvres ou séparés de leur famille et confiés à la protection de l’enfance, alors qu’ils sont les plus vulnérables et qu’ils devraient bénéficier d’une attention plus grande, sont au contraire les premières victimes des dénis de droit. Comme le comité des droits de l’enfant de l’ONU l’a signifié à la France en janvier 2016, nous avons donc des progrès à faire. De plus, l’augmentation d’enfants pauvres est inquiétante. Lorsque l’on a froid, que l’on est en mauvaise santé, ou mal logé, les autres droits sont tributaires de ces conditions quotidiennes et de la peur du lendemain. L’enfant ne peut, dans ce cas, être disponible pour se concentrer à l’école. Nous arrivons forcément aux questions des moyens financiers et finalement la grande question à se poser est « Nos enfants sont-ils prioritaires ? ». Voulons-nous prendre le risque de construire une société qui nourrira de plus en plus de sentiments d’exclusion ?
*Rapport du défenseur des droits, « Une école pour tous, un droit pour chacun », 2016