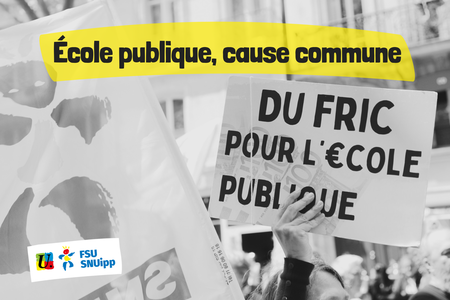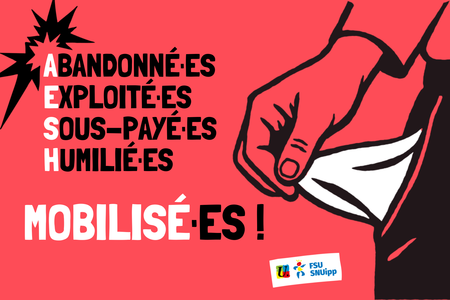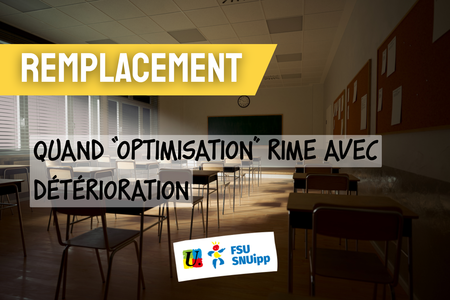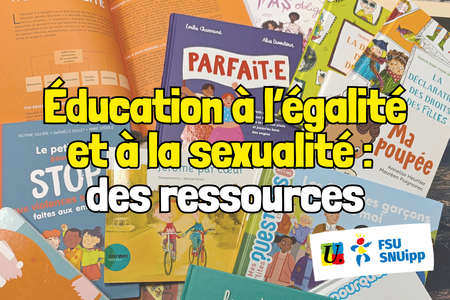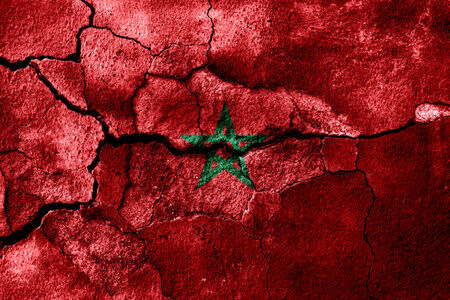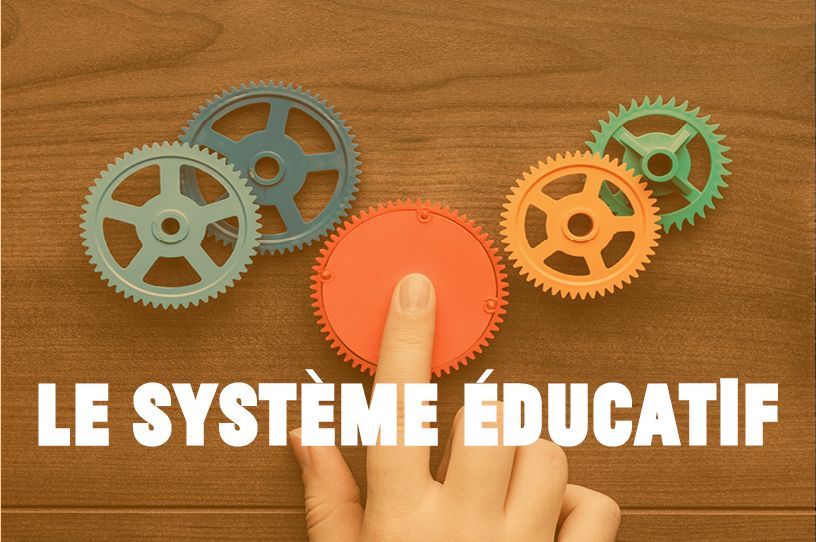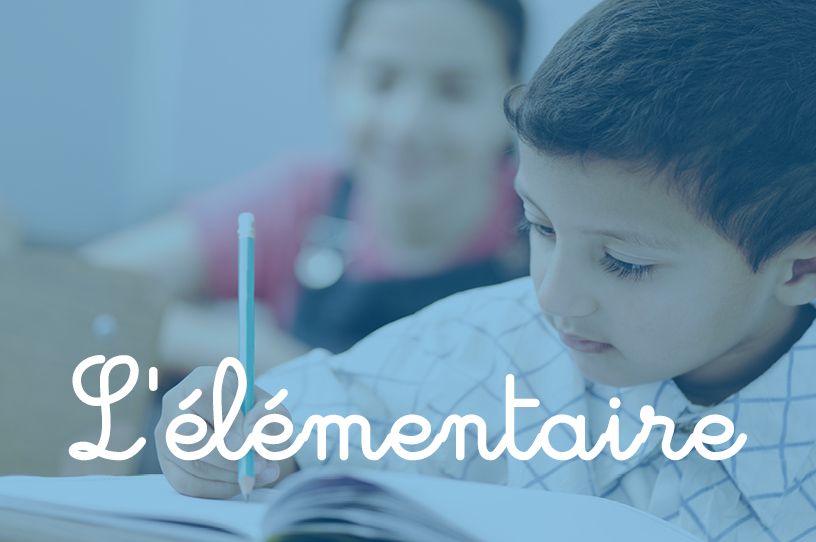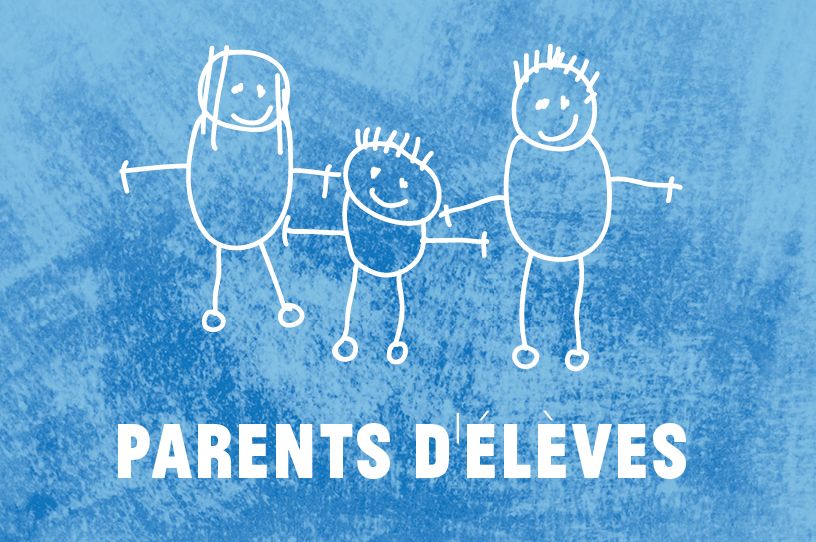"La représentation des personnages"
Mis à jour le 20.03.25
min de lecture
3 questions à Sarah Ghelam
SARAH GHELAM est chercheuse en sciences humaines et sociales et autrice d’« Où sont les personnages d’enfants non blancs en littérature jeunesse ? », Éditions On ne compte pas pour du beurre.

COMMENT SONT REPRÉSENTÉS LES ENFANTS NON BLANCS DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE ?
Il y a une augmentation certaine du nombre de personnages d’enfants non blancs dans les albums jeunesse, en particulier ces trois dernières années, liée sans doute à une hausse de la production mais pas uniquement. Toutefois, cachés derrière cette augmentation, certains manques persistent. La majorité de ces albums se situent à l’étranger. Sans réel récit, il s’agit plutôt de leçons d’histoire-géographie à destination du lectorat français, occidental.
Leçon par ailleurs erronée puisqu’il y a, là aussi, des logiques de surreprésentation – l’Afrique rurale et précoloniale – et d’invisibilisation telle que l’Afrique contemporaine et urbaine. Lorsque ces albums se situent dans un contexte occidental, les personnages d’enfants non blancs servent là aussi de leçon, à l’altérité cette fois, mais toujours au profi t d’un lectorat blanc. Lorsque le personnage d’enfant non blanc ne sert pas à l’éducation de l’enfant blanc, il est simplement colorisé, c’est-à-dire qu’aucun élément culturel spécifi que n’est présent dans l’album.
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES ?
En sociologie, on pense la littérature jeunesse comme un espace de socialisation, c’est-à-dire, un espace où l’enfant va, comme à l’école ou dans la sphère familiale, intégrer des normes sociales, construire son identité et son rapport au monde. Quand on pense la littérature jeunesse de cette façon-là, il est évident que l’absence de certains enfants, certaines pratiques et certaines expériences vont avoir des conséquences sur les enfants à qui sont lus ces albums. L’enfant non blanc intégrera qu’il n’est pas important, l’enfant blanc s’habituera à ce que son point de vue soit la norme.
COMMENT UTILISER LES ALBUMS DANS UNE ÉDUCATION ANTI-RACISTE ?
Il n’existe pas d’albums parfaits en toutes circonstances et il n’est évidemment pas question de détruire tous les albums avec des stéréotypes racistes. L’important est donc de penser à comment sont représentés les personnages d’enfants non blancs au regard de l’usage qu’on souhaite faire de l’album. Des albums véhiculant des stéréotypes racistes peuvent-ils être envisagés pour servir d’appui lors de séances visant justement à les analyser ? Un album ethnographique sur l’Afrique du Nord, quand une partie des élèves en sont issus, est-ce vraiment intéressant ?
Il existe, par ailleurs, des albums antiracistes, à l’intérieur desquels les rapports sociaux de race sont questionnés, comme « Le chemin de Jada », où Jada est victime de colorisme, « Comme un million de papillons noirs », où Adé est victime de violences racistes ou bien encore Le musée mal rangé, où une classe questionne les biais racistes des institutions françaises. Dans ces albums, il s’agit de responsabiliser tous les enfants, pour agir à l’endroit des discriminations raciales. Il ne s’agit pas d’apprendre à tolérer quelqu’un de différent, mais de construire un nouveau monde, à l’échelle d’une classe, sans domination de pouvoir.