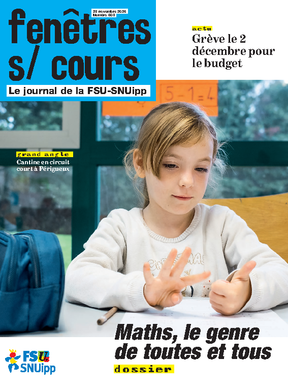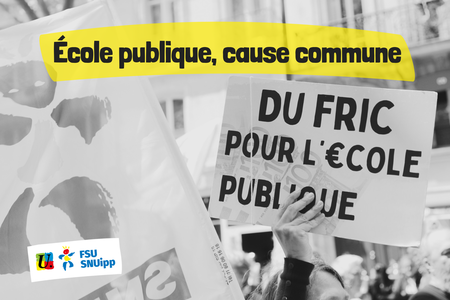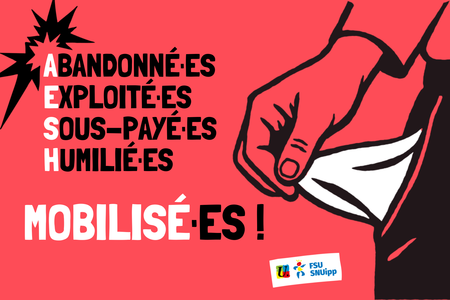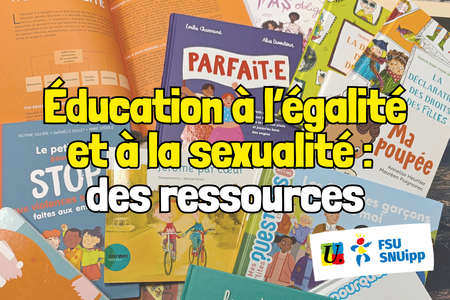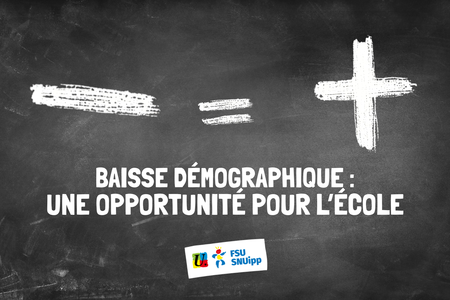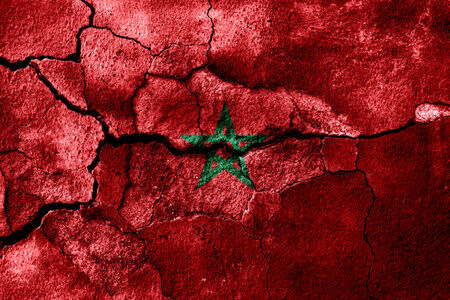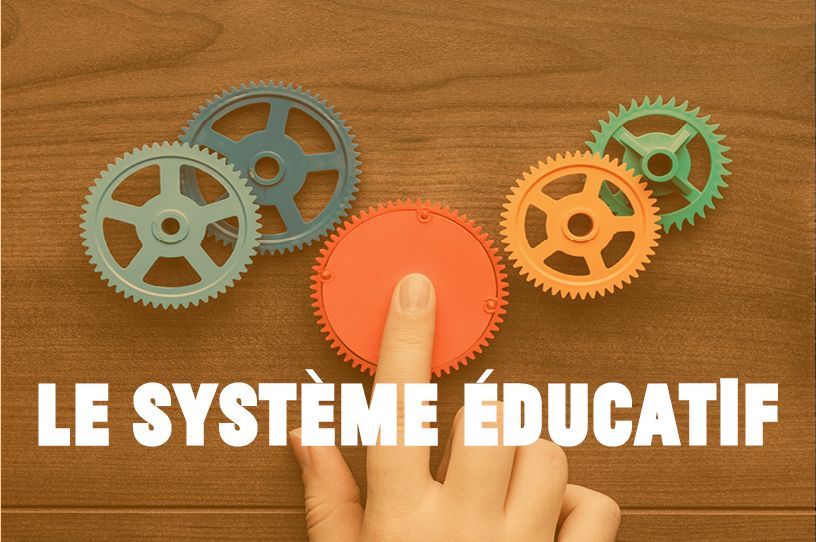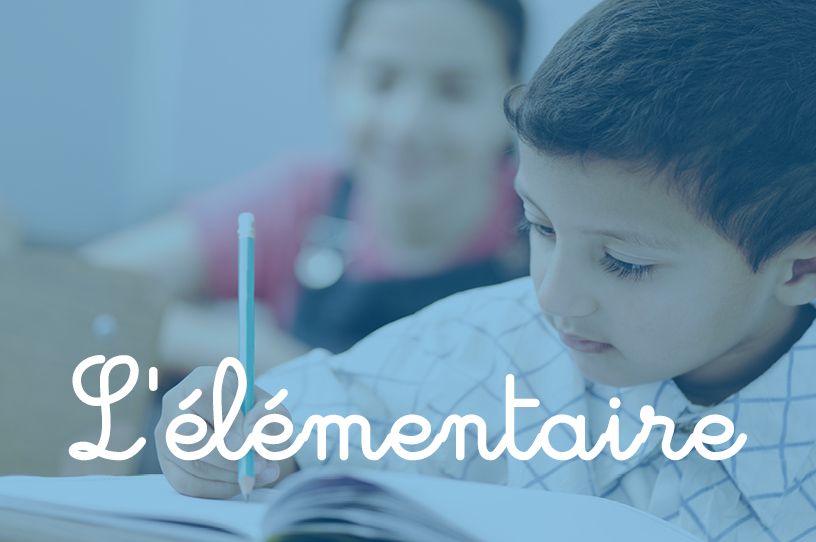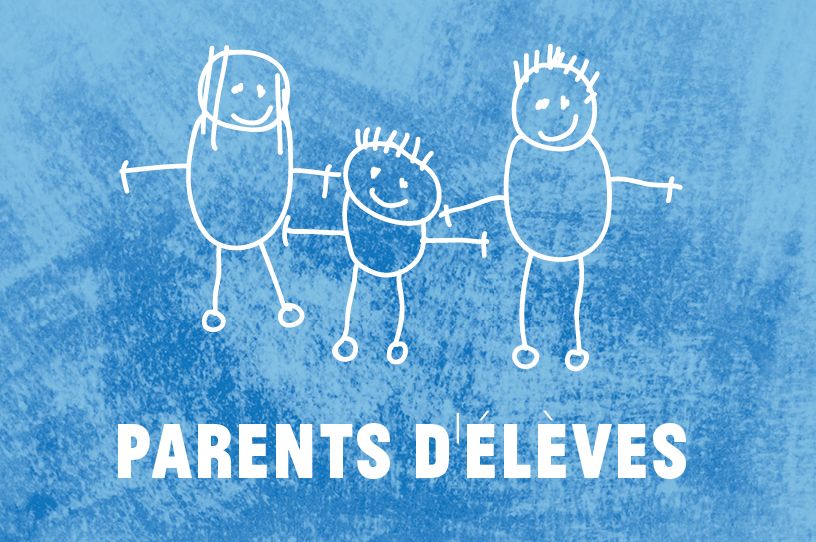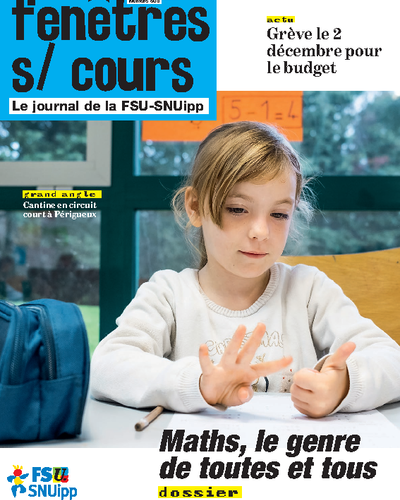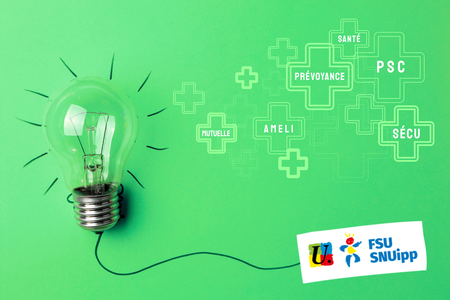De nouveaux projets de programmes en cycle 3
Mis à jour le 14.03.25
min de lecture
Les nouveaux projets de programmes pour le cycle 3, rendus publics dans la continuité des programmes des cycles 1 et 2 d’octobre 2024, soulèvent de nombreuses inquiétudes. S’ils contiennent quelques points d’appui, leur conception s’inscrit dans une logique prescriptive et normative, qui risque de creuser les inégalités et de ne pas garantir à toutes et tous l’accès aux savoirs et à une véritable émancipation intellectuelle.
Français : une structuration rigide qui freine les apprentissages
Une approche éclatée, éloignée de la notion de cycle
L’organisation du projet de programme repose sur une séparation stricte entre lecture, écriture, oral, vocabulaire, grammaire et orthographe. Cette structuration favorise une approche purement applicative, où les élèves doivent avant tout maîtriser des règles plutôt que de comprendre la langue comme un outil d’expression et de pensée dans son ensemble.
Des activités au détriment de la construction des savoirs
Le texte met en avant des « activités », mais sans expliciter les savoirs à construire en amont. Par exemple, la dictée quotidienne devient un rituel imposé, sans réflexion sur son intérêt et sur ce qu’elle peut provoquer pour les élèves. Or, la sociologie des apprentissages montre que cette approche peut enfermer les élèves les plus fragiles dans des tâches mécaniques vides de sens, sans leur donner les clés de la compréhension et sans les faire progresser.
Des enseignant·es exécutant·es, des élèves chronométré·es
Le programme impose un rythme rigide aux enseignantes et enseignants, en prescrivant des objectifs hebdomadaires et quotidiens. Du côté des élèves, des objectifs chiffrés (CM1 : 110 mots/min, CM2 : 120 mots/min) transforment la lecture en un exercice de vitesse, au détriment de la compréhension. Ce qui était auparavant un indicateur permettant notamment d’évaluer les élèves, devient un objectif en soi. Comme le rappelle la loi de Goodhart, “lorsqu’un indicateur devient une cible, il cesse d’être pertinent”.
Une différenciation qui creuse les inégalités
Le texte insiste sur l’automatisation du déchiffrage, notamment pour les élèves en difficulté, tout en réservant les stratégies de compréhension à d’autres domaines. Ce cloisonnement enferme les élèves les plus fragiles dans un rapport mécanique à la lecture, limitant leur accès à la culture écrite.
Des contradictions à exploiter
Certains passages du texte peuvent cependant être mobilisés pour défendre un enseignement plus équilibré, comme l’affirmation selon laquelle « l’enseignement de la lecture et de l’écriture s’envisage de façon complémentaire et simultanée ». De même, l’écriture y est reconnue comme un outil de pensée et d’apprentissage transversal à toutes les disciplines.
Un retour des références culturelles… sous contrainte
Le projet propose des œuvres littéraires à lire, ce qui est positif. Cependant, la création de listes obligatoires pose problème : ces dernières risquent de devenir obsolètes et de figer les pratiques. La FSU-SNUipp demande qu’elles restent évolutives via Eduscol, comme en 2002.
Mathématiques : une vision techniciste et opposée à la liberté pédagogique
Une approche inspirée des pays les mieux classés aux évaluations… mais à quel prix ?
Les concepteurs du projet de programme affirment s’être alignés sur les pays obtenant de bons résultats aux évaluations internationales. Le syndicat rappelle cependant que la réussite des élèves ne dépend pas uniquement des contenus enseignés, mais aussi d’autres facteurs tels que les effectifs de classe ou bien encore la formation des enseignantes et des enseignants.
Un programme prescriptif et normalisant
Comme en français, le projet de programme de mathématiques repose sur une architecture rigide, avec des « exemples de réussite » visant à uniformiser les pratiques enseignantes. Lorsque la FSU-SNUipp a souligné son caractère excessivement prescriptif, les concepteurs ont répondu que cette approche était nécessaire face au nombre croissant de contractuel·les. Cette logique privilégie donc la mise au pas du métier enseignant plutôt que le développement d’une véritable formation professionnelle ambitieuse.
Des inégalités d’apprentissage et de genre ignorées
Le texte mentionne la lutte contre les inégalités scolaires et les écarts filles-garçons, mais sans proposer de pistes concrètes. Pire, il introduit les devoirs à la maison en mathématiques, tout en reconnaissant qu’ils creusent les inégalités sociales, supposant que l’enseignant·e saura contourner cet écueil… Une contradiction de plus, dont la FSU-SNUipp demande le retrait.
Une approche du nombre et du calcul qui va à l’encontre de la recherche
Le projet met l’accent sur l’application de procédures dites « efficaces », sans prise en compte du sens des opérations. Cette approche instrumentale va à l’encontre des recommandations du CNESCO, qui rappelle que « le formalisme prématuré nuit à la compréhension des nombres ». En privilégiant la rapidité d’exécution plutôt que la construction du raisonnement, ce projet de programme risque d’augmenter les « malentendus scolaires » (obstacles qui empêchent les élèves de répondre aux attentes de l’enseignant·e et de l'institution) et de pénaliser les élèves des classes populaires.
De plus, il persiste dans une conception éclatée du nombre, avec une séparation rigide entre construction du nombre, calcul mental et techniques opératoires. Or, comme le soulignaient les programmes de 2015, ces trois dimensions doivent être articulées pour favoriser une compréhension globale des mathématiques.
L’accent mis sur la « fluence numérique » (15 résultats restitués en trois minutes) reflète cette logique mécaniste, au détriment du développement d’une intelligence du calcul flexible et adaptée aux contextes numériques variés.
Quelques points positifs, mais en contradiction avec l’existant
Le lien établi entre nombres décimaux et fractions décimales est une avancée, en cohérence avec le système international d’unités. Cependant, cette approche entre en contradiction avec l’introduction des décimaux par la monnaie dans les programmes de cycle 2, qui risque de renforcer l’idée fausse qu’un nombre décimal est un simple assemblage de deux nombres entiers.
Une approche réductrice des problèmes
Si la notion de problème est présente dans le texte, elle est souvent réduite à une simple traduction mathématique de situations de vie quotidienne, avec un traitement strictement arithmétique et fortement protocolaire. Cette vision appauvrie ne permet pas de développer une véritable capacité de modélisation mathématique.
Un programme surchargé, au détriment des apprentissages
L’introduction de nouveaux domaines (algèbre, probabilités) pourrait être une avancée intéressante pour préparer le cycle 4. Toutefois, sans allègement du reste du programme, cela risque de conduire à une surcharge, imposant un rythme d’apprentissage trop rapide et pénalisant les élèves les plus éloignés de la culture scolaire.
Ces projets de programmes de français et de mathématiques pour le cycle 3 s’inscrivent dans une logique prescriptive et normative, qui entrave la construction des apprentissages et accentue les inégalités scolaires. Entre segmentation excessive des savoirs, rigidité et approche mécaniste des apprentissages, ces textes ne permettent pas d’assurer à tous les élèves un accès équitable aux savoirs.
La FSU-SNUipp alerte sur ces dérives et revendique des programmes qui privilégient la compréhension, la réflexion et l’émancipation intellectuelle, plutôt que la simple application de procédures standardisées. Elle demande à ce que ces projets soient revus et ne s’appliquent pas à la prochaine rentrée, elle portera cette exigence dans les instances.