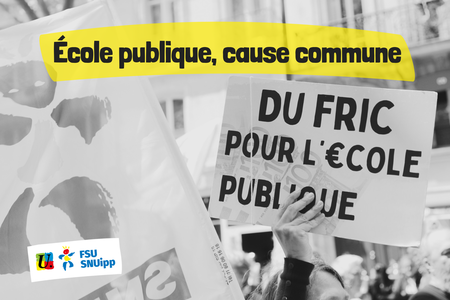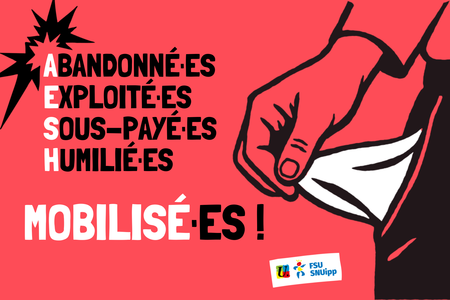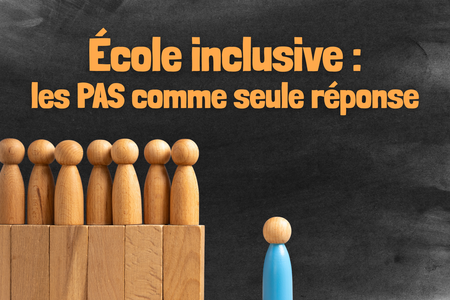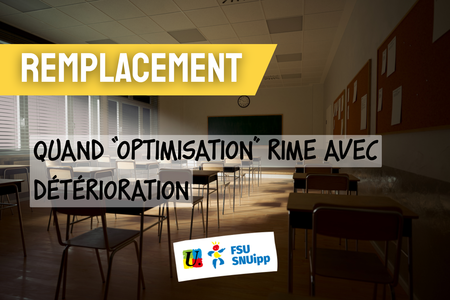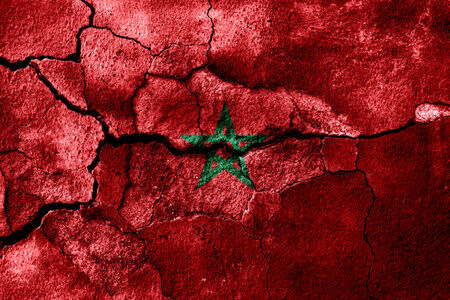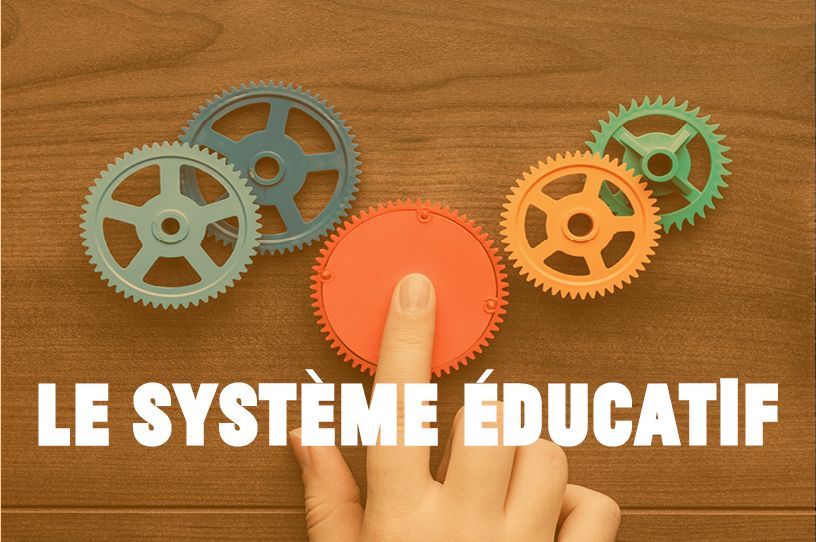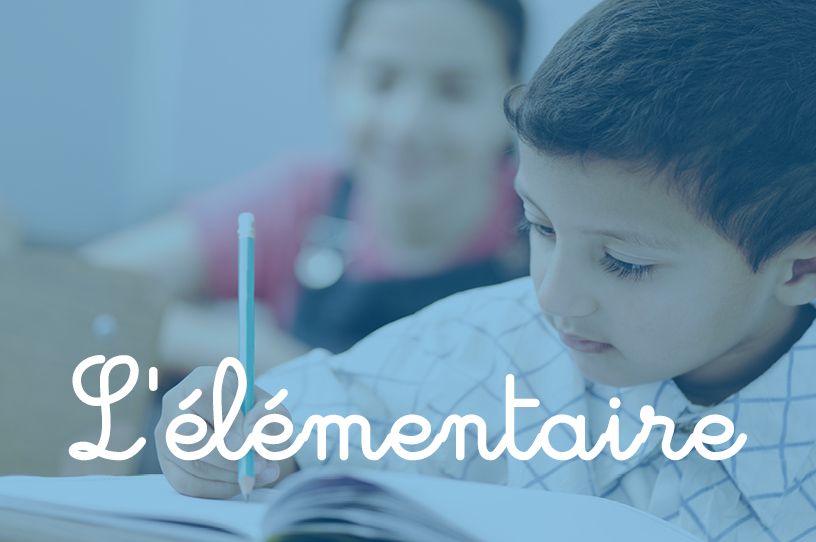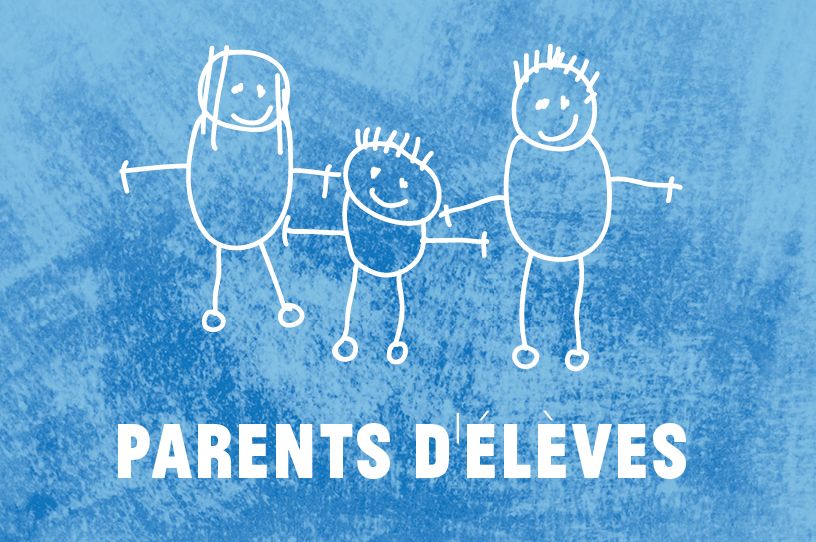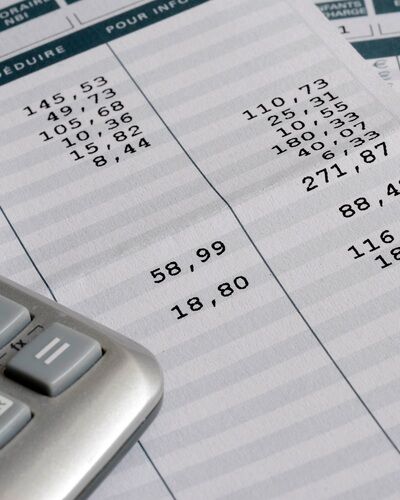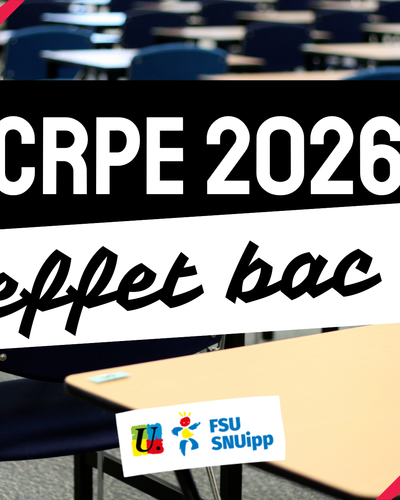“Une réappropriation pour ne pas perdre le sens”
Mis à jour le 19.12.21
min de lecture
Travail sous confinement...la volonté de préserver la cohérence du collectif est très forte et renforcée par une volonté d'équité.
Cécile Berterreix est formatrice à l’INSPE de Pau et doctorante en sciences de l’éducation

Quelles ont été les conditions de reprise pour le PE après le confinement ?
Après deux mois anxiogènes de confinement, les enseignantes et enseignants commencent à stabiliser les formes de travail à distance. Malgré la réouverture des écoles annoncée pour le 11 mai, le protocole sanitaire fixant les modalités de réouverture n’est relayé que six jours avant, augmentant la complexité et l’anxiété. Les professeurs d’écoles mesurent les enjeux sociaux et économiques mais s’inquiètent à la fois des risques épidémiques et des modalités opérationnelles de mise en œuvre. Le déconfinement s’ouvre sur une urgence à penser les aménagements, l’organisation des groupes d’élève issus des familles volontaires pas toujours connus, la réorganisation du travail en équipe, la gestion du présentiel associé à du distanciel dans un temps restreint.
Quelles ont été leurs préoccupations ?
Elles sont de quatre ordres : le sanitaire, le traitement des difficultés, l’engagement des élèves et des questions éthiques. Alors que le groupe classe est bousculé avec une partie présente et une autre à distance, il s’agit de concilier des activités individuelles tout en retrouvant une dynamique de groupe mise à mal par l’espacement requis. La volonté de préserver la cohésion du collectif est très forte et renforcée par une volonté d’équité entre élèves en présence et ceux à distance. Cela va engendrer une vigilance au rythme des apprentissages des uns et des autres. La question du bien-être des enfants va rapidement se poser aussi, en particulier veiller à mobiliser des corps contraints à une sédentarisation.
A quels empêchements professionnels ont-ils été confrontés ?
Les enseignants sont contraints de transformer les activités antérieures, ôtant parfois des dimensions qui faisaient sens pour eux dans leur travail. Le renoncement aux situations de recherche en sous-groupes ou aux corrections croisées par exemple obligent à un enseignement plus frontal, plus individualisé. Une multitude de domaines d’EPS sont empêchés du fait du protocole. Les PE la « revoient à la baisse » en la transformant en « un temps pour bouger ». Les contrariétés sont particulièrement fortes en maternelle où la proximité affective est empêchée. Mais progressivement, au fil des semaines, une certaine réassurance et un besoin de retrouver le cœur du métier entraîneront quelques lâcher-prises.
Ils ont donc adapté leurs pratiques ?
On note deux types de transformations. D’une part des transformations visibles avec des activités remaniées : un « quoi de neuf » ciblant ordinairement des apprentissages langagiers précis devient un temps de correspondance pour les camarades absents ; un plateau collectif du jeu de société est transformé, affiché sur un TBI ; l’ardoise devient un outil d’étayage intermédiaire enseignant-élève... Il ne s’agit pas d’innovations mais de repenser les activités habituelles. De même, les situations sont davantage explicitées et répétées. Mais il existe aussi des transformations silencieuses. Lorsque les enseignantes et enseignants sont amenés à veiller aux respects des nouvelles règles protocolaires. « Ne pas gommer puis souffler, ne pas donner la main, ne pas se déplacer en autonomie» constituent une multitude de gestes habituels à réfréner. C’est invisible mais très coûteux. De même l’envie de suivre l’ensemble des élèves de la classe le plus équitablement possible malgré les groupes irréguliers en concevant les activités à la fois pour le distanciel et le présentiel va constituer une véritable question d’éthique. Ces réappropriations du travail visent à ne pas perdre le sens d’un métier dont le cœur est malmené par ce contexte de pandémie.
Des satisfactions ?
Malgré un fort épuisement, notamment lié aux évolutions du protocole obligeant à de nombreuses réorganisations, malgré des renoncements de pratiques antérieures choisies, les enseignants ressentaient de la satisfaction lorsqu’ils estimaient avoir réussi à offrir des conditions respectables d’accueil. Ils en éprouvent également à force de persévérance et de tâtonnements, lorsque l’activité redéfinie finit par fonctionner. Passer de 28 à 12 élèves a également été un facteur de calme, de possibilité de mieux accompagner les enfants. Enfin, le lien institué avec les familles, les remerciements, les prises de conscience de la difficulté d’enseigner ont permis un sentiment de reconnaissance. D’une manière générale, les satisfactions furent liées à la dimension humaine et sociale du travail, à la préservation du sens.